Aujourd’hui: Revival, hommage, tribute et intelligence artificielle.
Le renouveau du Rock’n’Roll? Le mot devrait être conjugué au pluriel tant les métastases de notre musique préférée furent nombreuses. Les isolés américains de Sha na na ou Flash Cadillac, les pionniers du Psychobilly Cramps ou Meteors, les britanniques Crazy Cavan ou Dave Edmunds, autant de manières différentes d’interpréter le Rock’n’Roll en le dépoussièrant.
Au milieu des années 70, on assista à la naissance de ce qui deviendrait le Punk Rock et sa descendante plus sage la New Wave. Les artisans de ce mouvement étaient assez divers mais partageaient le même refus des conventions désormais établies alors. L’académisme, les cheveux longs et les solos de guitares interminables étaient à bannir pour être remplacés par une approche plus directe voire carrément primitive de la musique. Si le Punk en soi dura peu, il permit l’éclosion de nouveaux mouvements et le retour à des genres parfois négligés, comme le ska. Ou une revitalisation comme ce fut le cas avec le Rock’n’Roll. D’anciens punks – ou assimilés- s’y employèrent à l’exemple de Brian Setzer qui passa des New Wave Bloodless Pharaohs aux très Rockabilly Stray Cats. Setzer et son gang, bien qu’américains durent passer par la case anglaise avant revenir triomphalement chez eux ou le public n’acceptaient cette musique pourtant profondément nationale. Cela ouvrit une porte qui donna des idées à certains.
Soit Bruce Springsteen, Paul MacCartney, Lou Reed, Willy Deville ou Moon Martin n’attendirent pas cette apparition pour cligner de l’oeil aux Fifities – leurs racines. Mais ils étaient loin de rendre des hommages intégraux comme le firent Neil Young et Billy Joel en 1983. Suite à une longue série d’échecs, Neil Young décida d’enregistrer un album d’obédience Rockabilly mélangeant reprises et compositions personnelles. Hélas, s’il stupéfia tout le monde, le disque n’enrichit pas davantage son auteur que ses opus précédents. L’échec fut tel que le label de Young attaqua ce dernier en justice, arguant également du fait qu’en plus du reste ce n’était pas un « album de Neil Young ». Parallèlement, Billy Joel (Resté célèbre chez nous pour son duo avec Michel Drucker, c’est désopilant) baignait dans le succès grâce au simple « Uptown girl » extrait de l’album « An innocent album ». Baignant à l’instar de Neil Young dans la nostalgie de la période 56/62, il se différenciait toutefois du canadien en optant pour le Rhythm’n’Blues, le Doo Wop (Dont « Uptown girl » était un parfait exemple) et le débuts de la Motown.
N’importe comment, il s’agissait de deux oeuvres de qualité. Peu importe le perdant et le gagnant de l’histoire. Avant de passer au prochain paragraphe, les médias de l’époque inventèrent une rivalité entre les deux artistes. Lesquels n’étaient au courant de rien. Comme disait l’autre, ils racontent n’importe quoi ces journalistes! Un merci au passage à la chaîne YouTube « Robert’s record corner » qui m’a fourni ces précieuses informations!


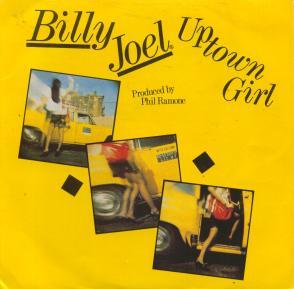
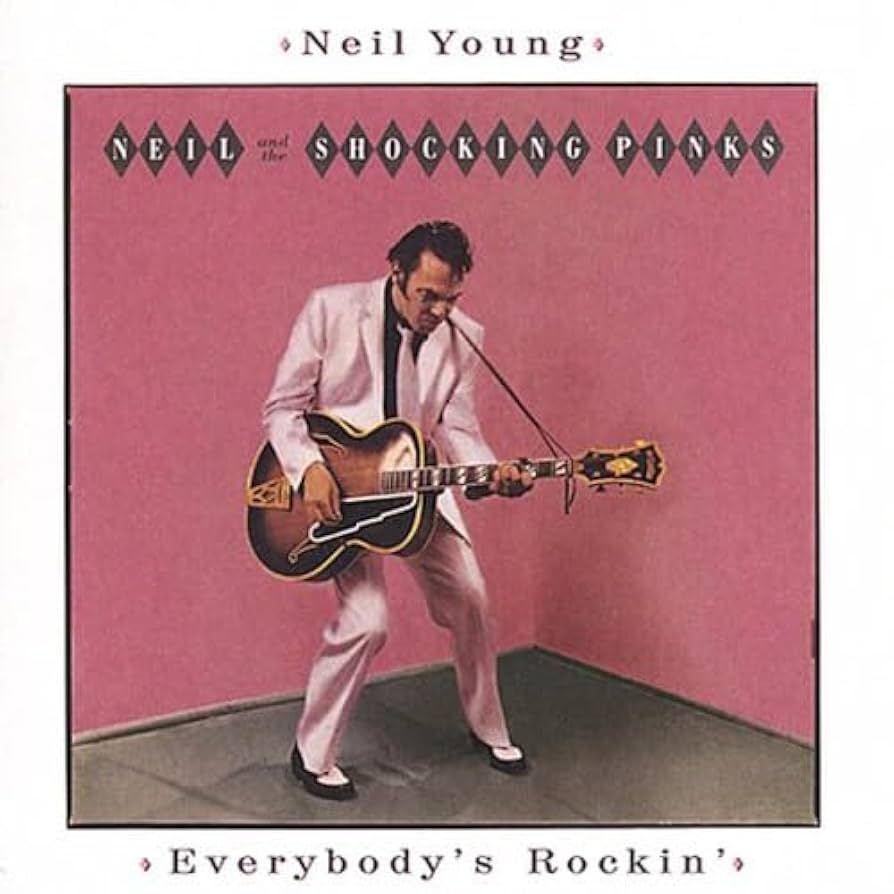
Pour en finir avec ce tour d’horizon, voici les très excentriques californiens de Big Daddy (Non, ce n’est pas du Rap!) auparavant connus sous le nom de « Big Daddy Dipstick and the Lube jobs ». Composé de comédiens de doublage, le groupe se caractérisa par des pots pourris improbables et des reprises de succès relevant de genres variés façon Fifties. Leur effort le plus mémorable en la matière fut leur version intégrale du SGT Pepper de Beatles dans un style délicieusement années 50. Les bougres étant excellents musiciens en plus d’être des pitres de haute tenues, le résultat est une exploit en cela qu’il réconcilie Rockers et fans des Fab four. Et ce par l’idée judicieuse consistant à emprunter le rythme de Buddy Holly, notamment sur « A day in the life ». Quoi de plus logique, les Beatles devant tant au maître de Lubbock, à commencer par leur nom…

